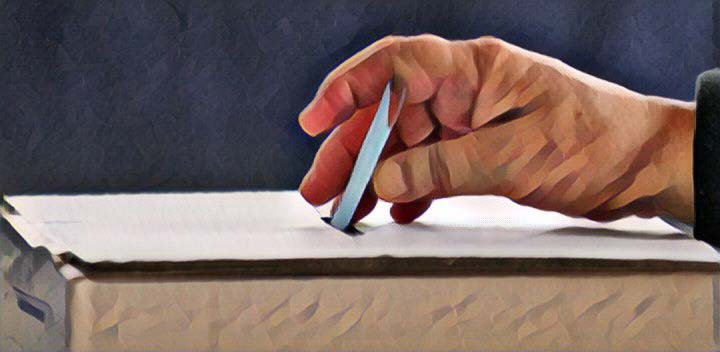Quelles sont les impacts du mode de scrutin sur la composition d’un gouvernement? La tenue d’élections libres et régulières se veut à la base de notre système démocratique. En permettant aux citoyens participer à la vie politique de son pays, les démocraties permettent des transitions politique fréquentes et en douceur. Notamment par rapport à la composition de son gouvernement et aux grandes orientations de celui-ci.
Si tous les systèmes démocratiques s’entendent sur le principe d’élections, les façons différent d’un État à l’autre. Nous comptons presque autant de variante que nous comptons de démocratie. Or, ces différences ont une grande influence sur la composition des gouvernements. C’est également le cas sur toute la vie politique d’un pays.
Deux grands modes de scrutin
Il est possible de regrouper les différents modes de scrutin en deux grandes familles. C’est à dire les modes de scrutin majoritaire et les modes de scrutin proportionnel. Ceux-ci se déclinent ensuite en plusieurs variantes qui ont chacune leurs spécificités.
Les impacts du mode de scrutin majoritaire
Les modes de scrutin dit majoritaire ont pour objectif d’identifier la force politique dominante. Ils favorisent la formation de gouvernement majoritaire tout en limitant la représentativité des autres partis. Cela renforce la stabilité des gouvernements et limite la multiplication des partis
Le principe d’un mode de scrutin uninominal majoritaire à un tour est simple. Il consiste à diviser le territoire en circonscription ayant plus ou moins le même nombre d’électeur. On doit ensuite y ternir des scrutin où le candidat ayant reçu le plus grand nombre de votes gagne. La formation politique ayant fait élire le plus grand nombre de candidats forme ensuite le gouvernement.
Il s’agit du mode de scrutin privilégié dans beaucoup des pays ayant un héritage britannique comme le Canada ou les États-Unis. Nous parlons de mode de scrutin uninominal lorsqu’un seul candidat est élu. Les scrutins plurinominal sont lorsqu’un vote permet l’élection de plusieurs candidats en une seule fois. Bien que la plupart des scrutins majoritaire ne compte qu’un seul tour, il existe des variantes qui permettent la tenue d’un second scrutin entre tous les candidats ayant franchie un certain seuil ou encore entre les deux principaux candidats lorsqu’il est souhaité que le candidat élu récolte au moins 50% +1 des votes exprimés. Nous parlons alors de scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
Les avantages d’un scrutin majoritaire
Les modes de scrutin majoritaire sont réputés étant simple. Il comporte peu de règles et le mode de scrutin uninominal majoritaire à un tour est facilement compris de tous. En plus de sa grande simplicité, un électeur, un vote, cette méthode a aussi pour avantage de lier le député à une circonscription, un territoire. Cela permet de mettre le représentant en relation directe avec ses électeurs.
Ce modèle comporte néanmoins certains inconvénients. Par exemple, l’un des impacts du mode de scrutin majoritaire apporte souvent des distorsions importantes entre le nombre de votes recueillis par un parti et le nombre de sièges qu’il reçoit. Il n’est pas rare qu’un gouvernement obtienne une majorité absolue de sièges malgré le fait qu’il n’ait obtenu que 35 ou 40% des votes. À l’inverse, les autres partis se voient sous représentés en terme de députés. Quant aux petits partis, il leur est quasi impossible d’arracher un siège même en représentant 5 à 10% de l’électorat. Cela réduit la diversité des partis ainsi que la représentativité de l’Assemblée.
Les désavantages du mode de scrutin majoritaire
Ce mode de scrutin a également comme impacts de rendre plusieurs votes “inutiles”. Les personnes votant pour des partis marginaux ne se voient pas représentés alors qu’ils représentent un certain pourcentage à l’échelle d’un pays. Inversement, tous les votes qu’un candidat récolte deviennent tout aussi inutiles dès qu’il obtient une majorité dans son comté. Gagner son comté avec 35 ou 80% des voix n’influe en rien la formation de la chambre.
C’est de cette manière que le Parti québécois de Lucien Bouchard a pu former le gouvernement du Québec en 1998. Or, il avait obtenu moins de votes que le Parti libéral de Jean Charest. Bien que ce dernier eu récolté plus de bulletins, ses appuis étaient principalement concentré dans un nombre limité de circonscription. De son côté, les appuis du Parti québécois étaient répartis de façon plus homogène dans la province. Cela a permit l’élection d’un plus grand nombre de candidats.
Les impacts du mode de scrutin proportionnel
Les modes de scrutin dit proportionnel, quant à eux, ont pour objectif d’offrir une représentation conforme à la volonté électorale en essayant de faire concorder le pourcentage de députés d’un parti avec son pourcentage de votes. Cela favorise l’émergence de nouveaux partis et une meilleure représentation parlementaire des électeurs, peu importe la tendance politique.
Toutefois, cette multiplication de partis rend plus difficile la création de gouvernements majoritaires, ce qui amène souvent des gouvernements de coalition moins stables. Un des impacts du mode de scrutin proportionnel est qu’il coupe le lien direct qu’un électeur peut avoir avec son député. En effet, le député n’est plus rattaché à une zone géographique précise, le citoyen n’a plus de “personne ressource” à qui porter ses doléances étant donné que sa région est représentée par plusieurs députés à la fois. Cela peut amener à une déresponsabilisation des députés face aux problèmes individuels des électeurs. Finalement, ce genre de mode de scrutin rend quasi impossible l’élection de candidat indépendant étant donné que celui-ci voit ses appuis noyés à l’échelle d’un pays ou d’une région.
Un bon moyen de contrer les effets négatifs des deux modes de scrutin est de mixer les deux régimes comme en Allemagne. Le scrutin proportionnel mixte compensatoire permet par exemple d’élire une partie des députés grâce à un mode majoritaire permettant ainsi le lien direct entre le député et l’électeur tout en contrant les distorsions inhérentes à ce mode de scrutin en compensant celles-ci avec l’élection de députés avec un mode de scrutin proportionnel.